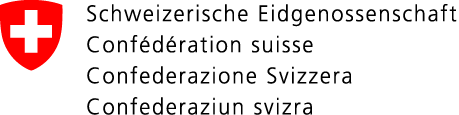Vous faites un cadeau au lobby routier dans cette ordonnance, en répondant à une exigence d’Auto-Suisse, dont vous étiez le président. Êtes-vous resté un lobbyiste de la route?
Non, sinon j’aurais pris des mesures complètement différentes. Au contraire: nous avons même mis en vigueur cette ordonnance avec effet rétroactif, au début de cette année. Cela signifie que les conditions de réduction des émissions de CO₂ doivent être respectées immédiatement. Le secteur avait des demandes, qui allaient bien plus loin. Cependant, nous avons effectivement tenu compte des concessionnaires automobiles, car le marché des voitures électriques se développe plus lentement qu’attendu.
Il était prévu qu’on ne puisse vendre une voiture à combustion supplémentaire que si dans le même temps une voiture électrique était vendue. Cette règle ne s’applique plus pour la plupart des concessionnaires. Est-ce un mauvais signal en termes d’incitation?
Le problème principal tient au fait que les voitures électriques étaient plus chères jusqu’à récemment. Les concessionnaires doivent de toute façon faire du marketing pour que plus de voitures électriques soient achetées. Sinon, ils sont sanctionnés. Mais cela n’a pas de sens si des centaines de millions d’amendes sont infligées. Ce ne sont pas les importateurs de voitures qui paient en fin de compte, mais les consommateurs avec des prix plus élevés.
Là aussi, vous allez dans le sens de votre ancien lobby.
L’électrification des transports prend un peu plus de temps que prévu. Nous avons fait un petit geste pour répondre aux difficultés économiques des concessionnaires, sans aller plus loin que l’UE.
Les entreprises qui s’engagent à réduire leurs émissions seront exemptées de la taxe sur le CO₂ à l’avenir. Vous avez également fait un geste en leur faveur en abaissant l’objectif de réduction de 2,5 à 2,25%. Justifié?
Jusqu’à présent, nous n’avions pas d’objectif minimal de réduction fixe. Il est vrai que nous avons également fait des concessions aux entreprises. Mais elles avaient demandé la suppression pure et simple de cet objectif minimal. Et nous pourrions même théoriquement atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050 si les entreprises réduisaient leurs émissions de CO₂ de seulement 2% par an. Nous avons fixé des objectifs un peu plus élevés, car nous pensons que ceux qui sont exemptés de la taxe sur le CO₂ devraient faire un effort plus grand que la moyenne.
Parviendrons-nous malgré tout à réduire nos émissions de CO₂ de moitié d’ici à 2030?
Je suis confiant. Je pense que nous parviendrons à atteindre tous les objectifs d’ici 2030 et qu’environ deux tiers des réductions pourront être réalisées dans le pays, comme l’exige le Parlement.
Et le zéro émission d’ici 2050, c’est toujours réaliste?
Une chose est claire: nous voulons la décarbonisation. Mais en même temps, nous ne devons pas fermer les yeux sur le fait que notre économie dépend à 50% des exportations et que la compétitivité est essentielle. C’est pourquoi je préfère miser sur l’innovation plutôt que sur une augmentation des prix de l’énergie. La question est de savoir si nous réussirons à atteindre les objectifs uniquement grâce à l’innovation.
Les États-Unis se sont retirés de l’accord sur le climat. La Suisse doit-elle poursuivre ses efforts?
Lorsque le Conseil fédéral formulera la nouvelle loi post 2030, il devra certainement tenir compte de l’évolution internationale.
L’UDC, votre parti, veut dénoncer cet accord. Et vous semblez maintenant dire: «on verra si on peut atteindre les objectifs?»
Non, la population a dit que la Suisse devait atteindre zéro émission nette d’ici 2050. Je m’y tiens.
Avez-vous aussi tenu compte des critiques de la gauche dans ce projet?
Je n’en ai pas connaissance. La plupart des acteurs de gauche ont jugé nos propositions globalement positives. Ils voulaient aller plus loin. Seuls les acteurs économiques les ont rejetées en bloc.
Le Conseil fédéral veut autoriser certaines méthodes de génie génétique. Sachant que la population a voté un moratoire en 2005 et que le Parlement l’a plusieurs fois prolongé, pourquoi vouloir assouplir les règles?
Le Parlement nous a donné ce mandat. Je suis convaincu que c’est une bonne idée. Les nouvelles méthodes dont on parle sont fondamentalement différentes des OGM conventionnels. Ici, on ne mélange pas de matériel génétique issu de différentes espèces, mais on reproduit des choses qui auraient pu se faire dans la nature. Il y a donc moins de risques. Les progrès dans ce domaine sont importants, ils ont même été récompensés par un Prix Nobel. La Suisse doit saisir cette opportunité, tout en tenant compte des réticences de la population. Cela passe par une vulgarisation, une évaluation des risques et un contrôle des produits. La liberté de choix du consommateur doit aussi être préservée.
Pourquoi faut-il une loi spécifique pour cela? Pour dissimuler le fait qu’il s’agit d’OGM?
Il n’y a jamais eu la volonté de cacher quoi que ce soit.
L’Office fédéral de la justice recommandait toutefois de tout regrouper.
Bien sûr, c’est une décision politique. Notre but est d’abord de montrer qu’on ne parle pas des mêmes méthodes: mélanger deux ADN d’espèces différentes ou mélanger deux ADN de la même espèce, ça n’a rien à voir. En proposant une nouvelle loi, on montre aussi à la population que le moratoire continuera de s’appliquer pour les OGM traditionnels. D’ailleurs, l’UE prévoit aussi une loi spéciale.
Tous les sondages montrent que la population ne veut pas d’OGM. N’allez-vous pas trop vite?
Je ne suis pas d’accord, le dernier sondage de 2024 montre que les gens sont ouverts à ces nouvelles technologies. Les choses évoluent très vite. L’UE avance plus ou moins au même rythme que nous, mais il y a déjà des produits qui sont utilisés en Amérique. Nous devons donc avoir ce débat. Ce sera des discussions intenses, mais nous pouvons les mener en toute tranquillité, car tant que la population n’a pas donné son aval, le moratoire sur les OGM reste valable.
Historiquement, les paysans étaient contre les OGM. Ça vous fait quoi à vous, fils de paysan, de leur ouvrir la porte?
Face aux problèmes de sécheresse ou de résistance aux produits phytosanitaires, ces nouvelles technologies peuvent être utiles. Et si vous m’interpellez en tant que fils de paysan, je peux vous dire que la pression pour aller plus vite dans ce domaine vient précisément du monde agricole.
Pas de BioSuisse, ni de l’Association des Petits Paysans, qui ont lancé une initiative populaire…
Cette initiative ne demande ni moratoire ni interdiction des nouvelles technologies. J’irais même plus loin, cette initiative correspond en grande partie au projet de loi que j’ai présenté. La différence réside uniquement dans des détails techniques.
Lancer la consultation alors qu’une initiative est lancée, n’est-ce pas un mauvais timing?
Au contraire. Cette initiative montre que même certains milieux critiques face aux OGM sont ouverts à la discussion. Ils veulent simplement s’assurer que l’évaluation des risques soit suffisante et qu’elle aille plus loin que celle prévue par l’UE. D’ailleurs, je pourrais très bien imaginer que ce projet de loi serve de contre-projet indirect à cette initiative.
Vous faites le parallèle avec l’UE. Mais l’agriculture suisse n’aurait-elle pas intérêt à rester sans OGM afin de se distinguer de ses concurrents?
Le moratoire actuel a sans doute aidé l’agriculture. Mais nous constatons aussi des problèmes d’approvisionnement en raison de l’interdiction de pesticides ou d’insecticides, liée notamment à la protection de l’environnement ou de la santé. La question qui se pose est: existe-t-il des alternatives qui nous permettent de nous passer de ces produits? Or, je ne vois pas à quoi cela nous servirait d’interdire ces nouvelles méthodes pour ensuite devoir importer massivement.
Imaginons que vous allez faire vos courses et qu’il est écrit sur le paquet «nouvelle méthode de sélection». Sur dix personnes, combien sauraient qu’il s’agit d’OGM?
Aucune, puisque cette dénomination n’existe pas. Mais dans deux ans, lorsque nous aurons débattu de cette question, ce sera différent. Les consommateurs sont très matures. Il y a 40 ans, personne ne savait ce que signifiait le bourgeon sur les emballages. Aujourd’hui, même les enfants savent ce que c’est du bio.
Les graines de ces plantes modifiées vont se répandre sur d’autres champs via le pollen. En tant qu’ingénieur agronome, pouvez-vous nous assurer qu’on pourra maintenir en parallèle des cultures non modifiées?
On ne peut peut-être pas être sûr à 100%. Mais avec des règles de distance strictes, on peut cantonner le risque à une partie négligeable des parcelles. Cela augure des discussions politiques dans la mise en œuvre, mais techniquement c’est possible. D’ailleurs nous l’avons déjà fait lorsqu’il fallait s’assurer que la production biologique ne soit pas impactée par les traitements utilisés dans l’agriculture traditionnelle.
Les autorités américaines ont récemment reproché à la Suisse son moratoire sur les OGM. Faut-il voir dans cette libéralisation une façon de répondre à ces critiques?
Non. Cela fait maintenant trois ans que nous avons reçu mandat du Parlement de travailler sur ce sujet. La situation politique aux États-Unis n’a joué aucun rôle.
Vous vous êtes fait remarquer l’an dernier en disant que vous auriez plutôt tendance à voter pour Trump. Êtes-vous toujours du même avis, maintenant qu’il prévoit d’imposer des droits de douane à grande échelle?
Ma déclaration visait surtout à dire que, politiquement, je me sentais plus proche du Parti Républicain que du Parti Démocrate. Mais pour moi, ça voulait dire une politique qui défend le libre-échange, pas une politique qui veut prélever plus de droits de douane.
Le Conseil fédéral est-il prêt quoique les États-Unis annoncent?
Oui, je répéterais ce que la présidente de la Confédération a dit il y a quelques semaines: il faut observer la situation et, sur la base des mesures prises, évaluer les conséquences pour notre économie. Le Conseil fédéral est très bien préparé. Il sait de quelle manière, dans quelle mesure et à quels niveaux une hausse des droits de douane impacterait notre économie.